2017 – in progress • 4×5″ contact platinum print on 8×10″ Arches platine paper



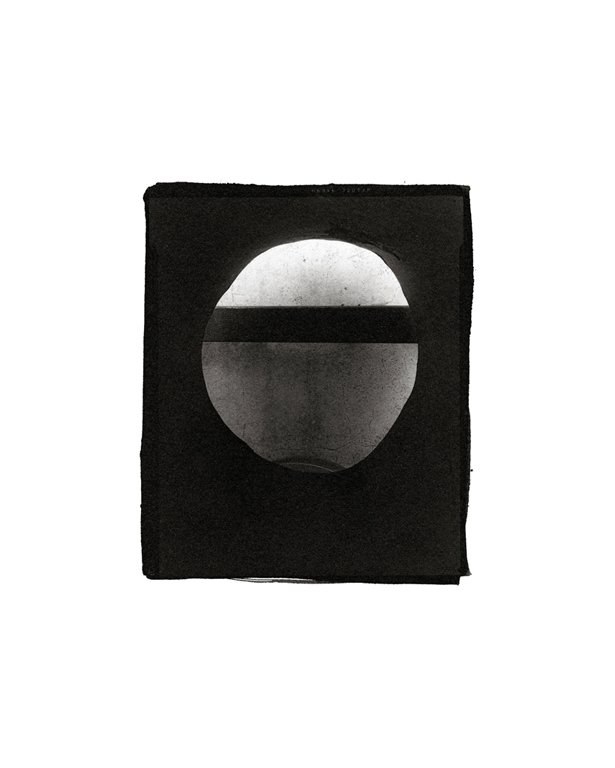






FLÂNERIES INACTUELLES
Il ne s’agit plus de parler de l’espace et de la lumière, mais de faire parler l’espace et la lumière qui sont là.
M. Merleau-Ponty
LA LIMITE • En cueillant le monde à travers la photographie, il y a une limite inviolable – et cette limite coïncide avec le monde déjà créé. Que l’on s’éloigne des tentations plus « objectives » ou que l’on épouse la subjectivité plus affirmée, on n’ira jamais outre. Cette réalité qui précède le langage photographique est la seule matière capable de l’exprimer. Par conséquent, la photographie penche naturellement du côté de la réception – singularité celle-ci d’un art basé plus sur la capacité d’écoute que sur la rhétorique. Un art qui crée en recevant et dont le « retentissement » serait le seul acte possible. Dans son analyse de l’image poétique (et extensible à mon sens à la genèse d’une photographie), Gaston Bachelard souligne que pendant le retentissement « nous parlons le poème » : ayant pris racine en nous-mêmes, il est devenu désormais « nôtre ». En recevant cette image poétique (photographique), « nous naissons à l’impression que nous aurions pu la créer, que nous aurions dû la créer ». Il s’ensuit que les lieux privilégiés où je crois pouvoir vivre ce « virement d’être », en disent beaucoup sur les possibilités de ma parole qui y trouverait assez de matière pour être finalement prononcée.
ESPACES BLANCS • Les espaces blancs de ma carte détaillée du territoire, leur éclat qui attire mon attention et, dans ce manque, attise le désir de les investir, d’y fouler les pieds. « Le vide – s’écriait encore Bachelard – cette matière de la possibilité d’être ! » Un vide apparent qui va bien au-delà des cartographies les plus soignées parce qu’inexprimable en sigles, abréviations, symboles et fonctions – espace de possibles, ouvert aux sens, démesuré car immensurable, indéfini car indéfinissable. Un vide silencieux, presque immobile, et loin d’être mort.
RICCHISSIMO NIHIL • Ces espaces m’ont toujours ignoré ; souvent ils vivotent en me tournant le dos, dans la plus totale autarcie, ritratti eux aussi. Ces espaces – solidités qui peuvent soudain m’accueillir ou m’exclure, se scinder ou me scinder ; espaces « ricchissimi » avant que je ne sois, il ne sont rien – nihil – si je ne suis pas.
SUR LE SEUIL • Vivre les espaces des zones périurbaines, rôder in limine, « sur le seuil », dans une proximité à l’essentiel dénuement de paysage, où chaque pas se veut plus proche d’un lieu délié du temps, cerné par les déviations, les tentatives d’itinéraires avortés, le manque de clairvoyance propre à l’errance. Chaque pas se veut plus proche à l’essentiel je disais, sans toutefois se risquer à en noter les coordonnées, à en tracer une carte fantomatique.
INSTANTS DE SISYPHE • Cependant que je parcours bout à bout ces rues décousues, en tâchant de ne pas me découdre à mon tour, d’un pas de suture je soulève la tête, tire le fil du sens puis, accablé à nouveau, aussitôt aveuglé, je m’enfonce encore dans cette peau bitumée d’ombre pour en resurgir quelques pas plus loin, et ainsi de suite – Sisyphe égaré dans les plaines.
ŒUVRE • Pendant mes flâneries à la lisière, je crois penser et agir au-delà des actions et pensées « réactives ». Dépourvu d’objectifs à atteindre, je poursuis par à-coups, m’enfilant dans les occasions qui s’ouvrent devant-dans moi. Je me laisse couler dans ces endroits inhospitaliers, gagnant le moindre recoin accessible. Plus je m’invite vers un lieu qui ne se limite pas à celui-ci, plus je creuse dans la « nappe de sens brut » que l’Histoire, en se fixant, sédimente. Là où l’être, pour être, n’a plus besoin d’une raison outre que sa matière et sa forme ; là où la matière et la forme deviennent à elles-seules oeuvre à recueillir (et non seulement dans le creux de la pensée). Cet ici – ce « lointain, si proche soit-il » dont je perçois l’aura – a percé le temps après y être allé en profondeur, après l’avoir possédé. L’aura que je poursuis émane d’un lieu-comète qui s’éloigne dès que je m’en rapproche, me guidant cependant d’une frêle lumière, à l’orée du visible.
EXCÈS • Pendant ces lieux suspendus, mon mouvement oscille entre l’intérieur et l’extérieur, tendant dans le meilleur des cas à l’unisson, au « retentissement ». Unisson d’autant plus rare car le périmètre se rétrécit vertigineusement. À la fois « errants, vagabonds » (du latin vagus), à la fois « désireux » (de vago en italien ancien), ces terrains vagues sont un défi qui se complique au fur et à mesure que se réduisent ses éléments. Et dans ce peu flottant – presque une nudité accablante – il y a encore un excès que je n’arrive que rarement à ôter.
LA PAGE NOIRE • Si l’écrivain se heurte au syndrome de la page blanche, je me heurte parfois à celui de la page noire. Ma page n’est jamais blanche : c’est le vaste monde qui m’entoure et que j’entoure. Dès lors l’impossibilité d’écrire a son équivalent dans l’impossibilité de lever, d’effacer. C’est donc l’excès de monde, le tassement du réel qui comble la page, parfois même avec des répétitions, gribouillis et non-sens. Face à cette saturation, je n’arrive à rien dire ni à être dit. Je regarde avec effroi la solidité d’un dehors que je sens de plus en plus exogène et dur – page remplie de « bavardages » encombrants, toute sillonnée de traits qui s’accumulent et se chevauchent, couvrant la blancheur du possible. Devant cette opacité qui se complaît dans chaque recoin, je me demande ce que je pourrais y inscrire, peut-être en creusant, peut-être en érigeant. Ma réponse, sûrement encore erronée mais sincère, est pour l’instant : « rien ».
COMPOSITION • Un paradoxe, plus cruel : essayer d’ordonner ce désordre absurde, vouloir y parvenir avec acharnement. Je cherche encore le point de ressenti et d’anamorphose qui séduit le hasard – angle qui condense dans une trame de rapports cet insouciant éparpillement de volontés et d’actions, avec le sentiment profond de la vision. Que je me force d’effacer ce paradoxe, il n’en demeure pas moins que c’est toujours avec le soin pour la composition que je tente de remédier à la décomposition ambiante ; c’est toujours en partant d’un rapport géométrique que je tente de « rendre visible » un rapport éminemment émotif.
STILLEVEN • Dans ce qui paraît inanimé et muet je découvre parfois la vibration d’une lumière vitale, possibles résurrections, naissances. « Natures mortes » les nomme la langue française, mais natures tout de même, au fond. Stilleven, stilleben (« vie silencieuse » ou « immobile ») comme l’expriment bien plus pertinemment le hollandais et l’allemand. L’impassibilité de ces natures, leur horizontalité coutumière : une majesté dépourvue de toute compassion et de toute piété qui ne baisse pas le regard, qui patiente et nous invite à considérer autrement leur « leçon ».
LA PUISSANCE DU SABLE • Dans un chantier le dimanche, la fibrillation devant un tas de sable, ces vocables en attente, infimes et puissants, seuls et solidaires, prêts à la construction d’un sens par-delà le non-sens, la petitesse sans fondements – cette vie d’argile mouillée qui s’érode. Le sable est la puissance à l’état pur, négation ou confirmation, résistance ou collaboration, dissidence ou acquiescement, côte à côte. C’est le point d’équilibre avant la prise de position.
APORIE • Même si j’essaie de « comprendre » ces murs, je ne peux que les recevoir sans ambages de rationalité. Ils me touchent et meuvent en profondeur, au point que je pourrais y rester dedans pendant des heures, sans m’en lasser. Car ils déterrent des interrogations qui demeurent en dehors du langage ; interrogations qui, dans l’impossibilité d’une réponse, demandent ne serait-ce qu’une paroi au déploiement de leur écho. Ravin ou vallée, je le suis sans savoir pourquoi. Ces murs s’offrent, et dans cette offre il y a une demande à peine perceptible, aux contours irréguliers démangés par le temps et l’incurie. Ils sont. Cela suffit à me plonger dans le dédale d’une question jamais prononcée. L’ampleur de cette aporie : sentir le besoin (la nécessité même) d’une réponse là où rien n’a parlé mais, tout pleinement, est.
HAPTIQUE DE LA VISION • Pour qu’il y ait photographie, je ne suis pas en face de quelque chose mais à l’intérieur. Une photographie doit être endogène, suivre une dynamique créatrice aux antipodes du soliloque et du cours ex cathedra. D’une simple vision qui présuppose un hiatus entre le voyant et le vu – cette profonde fracture dans le vécu – j’essaie de parvenir à une haptique de la vision, ma seule façon d’avoir une expérience singulière de la photographie.
Le mot haptique – du grec haptikos, « en mesure d’entrer en contact avec » et de hapto, « toucher » – définit la science du toucher et garde le même rapport perceptif au toucher que l’optique à la vue et l’acoustique à l’ouï. Elle englobe par ailleurs la perception de son propre corps dans l’environnement.
UNE SOLITUDE INTANGIBLE • In limine ma solitude est « intangible » mais non moins solidaire. Car si dans les faits cette solitude est bien réelle – je ne croise que peu de personnes pendant mes flâneries, et ce peu je le vis profondément comme un intrus se débattant encore dans le filet du quotidien –, elle ne l’est guère au fond. Sans cesse elle interroge, faisant de l’Autre à la fois l’objet de mes pensées et le sujet de mes photographies, mais d’une manière voilée. Cette attention à l’Autre risquant cependant de s’épuiser dans la seule pensée, il me fallait absolument revenir sur terre à l’humain, brouiller cette impérissable dichotomie, sous peine de m’enfermer dans un perpétuel décalage, sans interactions et vie qui ne soient pas en différée. L’humain, pour peu qu’on y prête l’oreille, pour peu qu’on s’en rapproche, est encore (et heureusement) là, même si ritratto.
RITRATTO
voir –
entrevoir –
croire entrevoir –
vouloir croire entrevoir.
S. Beckett
RITRATTO • Paysage à la fois charnel et émotionnel, le ritratto a presque son équivalent dans le français « portrait ». Mais ce dernier ne possède pas une signification fondamentale qui résonne dans le terme italien. « Ritratto » est ainsi le participe passé du verbe « ritrarre », du latin retrahere « faire revenir en arrière, ramener à soi par un mouvement de retrait ». Sous cet angle, le ritratto devient aussi ce (ou celui) qui se dérobe.
HIC ET NUNC • Cueillir ce retrait, l’absence de soi qui devient paradoxalement une présence généreuse : voici l’horizon de cette recherche. Après les premiers moments qui peuvent durer des heures ou des semaines, ce dépouillement de soi nous conduit à une présence plus nue. Car petit à petit tombent les oripeaux des représentations assumées, cèdent les postures trompeuses, les impostures. Dans les mots de Coline D. : « J’ai pu, à travers les photos, me découvrir sous un autre angle. Découvrir un regard, mon regard, pas joué, pas forcé, pas retouché. Ce n’est pas la beauté la plus importante dans ce projet, mais le regard, l’âme que l’on y puise. » Un espace profondément différent du théâtre quotidien se creuse, s’élargit. Une tension interne se fait lieu, une a-temporalité devient hic et nunc.
DURÉE DÉCISIVE • Pour tenter de le saisir, il faut tout d’abord bâtir un rapport de confiance, le seul en mesure de distendre ne serait-ce qu’un peu ce ritratto. J’ai procédé à la création d’un studio photographique minimaliste, en éclairage naturel, au sein même du Lycée Vieljeux à La Rochelle et de la Résidence de Beaulieu à Puilboreau. Un lieu ouvert à tous : élèves, résidents, personnels, visiteurs… À une séance de portraits faisait écho, la fois suivante, une prise de parole collective sur les images, suivie d’une nouvelle séance et ainsi de suite. « On revient donc tous les mardis après-midi – confie Margaux – comme pour un rendez-vous avec soi-même qu’on ne voudrait pas louper. » Cette durée décisive voit dans la multiplication des points de ressenti (cessons de les appeler toujours « points de vue », la vue n’étant qu’une infime partie de l’ensemble) la seule façon de creuser un portrait ouvert, né dans l’échange et le dialogue. Ainsi Coline F. : « C’est d’ailleurs une chose que j’ai apprise : c’est un travail de groupe. Bien que nerveuse la première fois que je me suis faite photographier, les fois suivantes m’ont mise de plus en plus à l’aise […] ; c’est donc avec le temps et la patience que la complicité entre le photographe et le photographié se tisse. »
FRACTURE • J’utilise une chambre photographique 4×5″. Issue du XIXème siècle et à l’aspect presque inchangé, elle sait interroger d’un œil lentement vif. À l’ère de la dématérialisation numérique, la « chambre » est une fracture dans la continuité du temps, une pause de réflexion sur soi dans l’accélération quotidienne. Argentique jusqu’au bout, suivant sa temporalité faite d’attente, de latence, de révélation et de partage, la photographie en noir et blanc – souligne Clélia – nous invite à « savourer cette attente tout comme les aristocrates savouraient le regard des peintres pendant des heures avant de voir le résultat de leur pose interminable. » L’utilisation de ce type d’appareil, couplé au négatif grand format, me permets en outre de prolonger l’interrogation photographique jusqu’au processus de tirage, au platine-palladium.
PARADOXE DE L’INEFFABLE • Je veux m’éloigner de toute rhétorique ou ruse, de tout topos ou tropisme, de tout expédient ou subterfuge. Puis, en face de la nudité qui se pose devant moi, me dénuder. Mais voilà un paradoxe de l’ineffable : ne pas pouvoir se mettre à nu sans disparaître ou faire disparaître, ne pas pouvoir desceller ses yeux sans se dissoudre ou pétrifier – regard d’Orphée vers Eurydice ou de Méduse.
RECUEILLEMENT • Plus que de la solitude, ce serait un recueillement qui ne soit pas dérangé par ma présence. Encore dans les mots de Margaux : « On se poste devant et la nervosité prend le dessus : un objectif comme des milliers de regards appuyés. Alors on a les mains un peu moites mais on se dit qu’on va le faire, que l’on va affronter cette lentille transparente comme si c’était le reste du monde. D’abord écrasé par la timidité, on finit par y prendre goût, à se dire que si on arrive à affronter l’oeil attentif du cyclope à trois pieds on arrivera à faire face à n’importe qui. » La surface de l’objectif est un défi – un abîme qui regarde l’abîme. Le ritratto tire ainsi son origine de l’ombre du non-dit qui l’accueille, lieu enfoui d’où il peut sortir avec son obscurité fragile : mais pas pour être illuminé – pour illuminer ; pas pour se dépouiller et nous montrer une prétendue âme – mais pour nous dépouiller et nous consentir de regarder, si jamais on y croit, la nôtre.
DISSEMBLANCE INTIME • Cependant, il reste malgré tout une distance irréductible – bien que de proximité – avec le ritratto. Un portrait ne doit pas l’effacer, il doit lui donner une épaisseur à même de la révéler. Si rencontre il y a, elle est entre, ni d’un côté ni de l’autre. Quand on regarde les portraits de la séance précédente, les réactions sont souvent les mêmes : « Je ne me reconnais pas dans cette image – je n’ai pas l’habitude de me regarder, vous savez – et pourtant c’est bien moi ». Il y a à la fois une étrangeté et une familiarité, un rejet et une attirance. Une dissemblance intime.
LA DOUBLE ABSENCE • Le ritratto est tout un art de la soustraction. Si, de mon côté, c’est dans la totale disparition de ma personne que je trouverais le rapport le plus simple pour aborder un ritratto, je dois malgré tout me rendre à l’idée que je ne peux pas rester longtemps en silence, laissant dans la plus encombrante solitude mon « modèle ». Je ne photographierais alors qu’une seule et même gêne réitérée à chaque pose. Je dois le guider – et ici réside le défi – en donnant l’impression de savoir où l’on va, tout en sachant que je suis aussi perdu que lui. Puisque il n’y a pas de voie tracée à suivre, mais un corps à sculpter se renouvelant sans cesse – à « libérer » du bloc de marbre aurait dit Michel-Ange. « Toute l’attention est portée sur moi, mon physique. L’oeil de l’appareil me fixe sans arrêt, je dois penser à autre chose ? Je ne vois que lui. Il me juge, que va-t-il tirer de moi ce portrait ? Clic. Mon esprit revient sur ma chaise, alors c’est comme ça que les autres me voient ? » écrit Oscar. Lorsque deux disparitions se font face et se superposent, on frôle le lieu de la création ; de cette double absence, en suivant le fil d’une confiance aveugle pour les deux desaparecidos, on peut même y demeurer quelques « secondes d’éternité ».
CHIASME • Que le monde se concède à celui qui sait le cueillir est chose connue bien que difficile ; qu’il faille en guider l’évolution, en rendre visible le profil est un tout autre défi. Dehors je peux créer en cueillant, recouper dans le fluide et l’immobile mais toujours dans un rapport où l’interaction avec le sujet de la photographie advient exactement à l’instant où celle-ci voit le jour, c’est-à-dire au moment fugace qui, grâce à cette ouverture, sort du temps. Ainsi en paysage mes interactions photographiques avec le « réel » ne s’interposent pas avec son déroulement, jamais elles n’en changent le cours de son existence, jamais elles ne perturbent sa vie silencieuse. Je scrute en retrait le fil de la vie, choisissant (lorsque je ne suis pas choisi) quand le couper. Mais ce fil aussitôt coupé – cette photographie encore latente – ne m’appartient désormais plus : elle est – œuvre à part entière, indépendante, respirant de sa vie autrement silencieuse. Le caractère sacré du réel et son inviolabilité s’estompent avec le ritratto, car il n’y a plus l’énigme d’un mur pour lequel je peux ne pas exister, mais un regard palpitant d’attente pour lequel j’existe, je dois. Si je peux redonner une vie autrement silencieuse au mur, je ne peux vraiment qu’éteindre d’une main l’étincelle de ce regard ?
